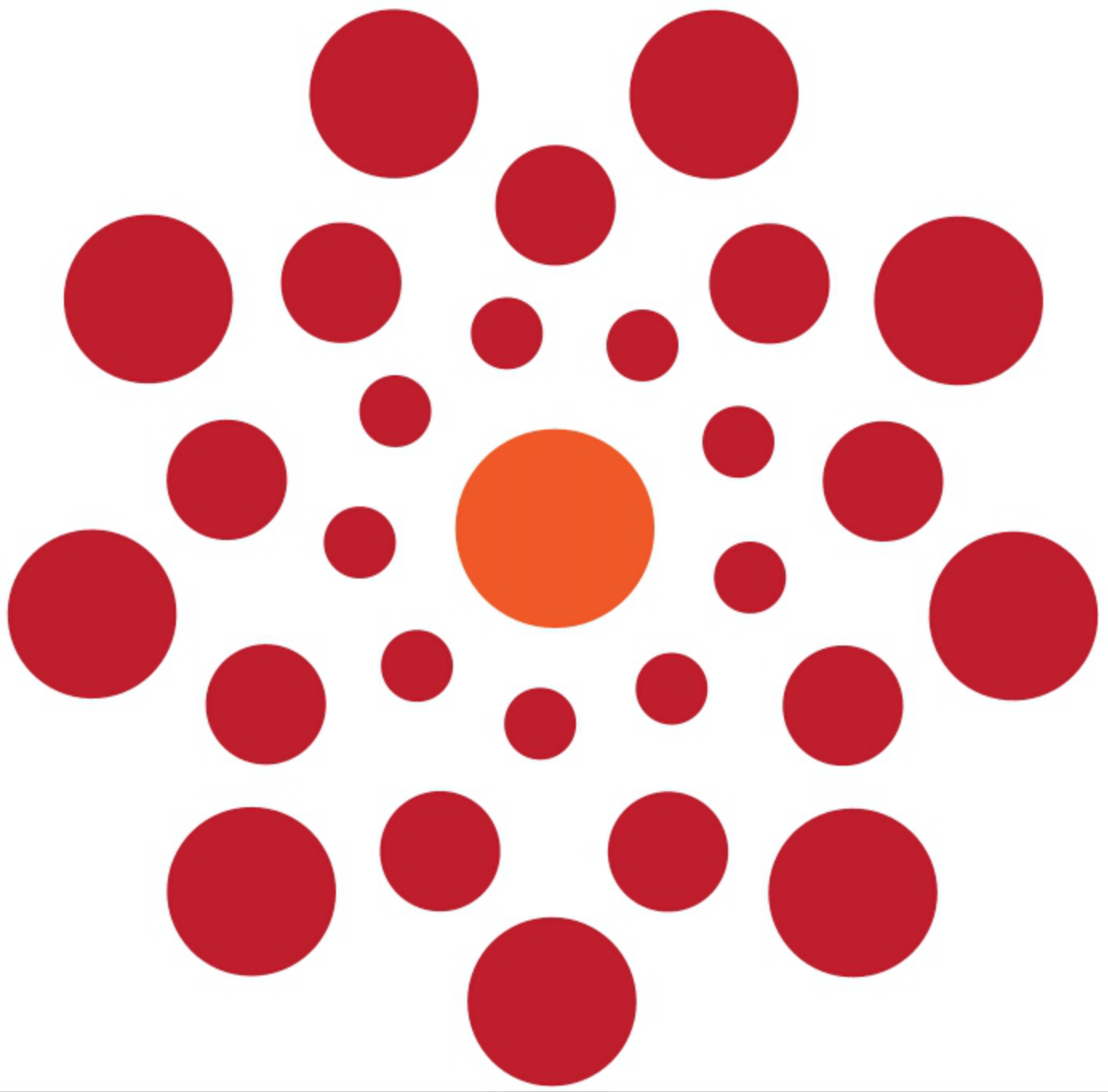L’évaluation d’impact n’est pas toujours la première chose à laquelle on pense quand on parle de festivals. Et pourtant, bien menée, elle peut devenir un formidable outil de valorisation. J’ai eu la chance, grâce à la fondation FRAISE, d’accompagner le festival Jazz à Sète dans cette démarche, et ce que nous avons appris ensemble dépasse largement la simple mesure d’indicateurs.

Donner du sens : pourquoi cette évaluation ?
À l’origine, la demande de l’équipe du festival était claire : disposer d’éléments concrets pour mieux valoriser le projet auprès des partenaires publics et privés. Au-delà de la simple fréquentation ou du budget, il s’agissait de mettre en lumière les retombées sociales, économiques, culturelles et environnementales du festival. En d’autres termes, raconter ce que le festival produit pour son territoire, ses publics, ses artistes – et pas seulement ce qu’il coûte.
Un festival, des impacts multiples sur des publics variés
Pour rendre compte de cette richesse, nous avons choisi d’interroger plusieurs parties prenantes : les spectateurs, les artistes programmés, les bénévoles, les partenaires et mécènes, ainsi que les commerçants et acteurs économiques locaux.
À ce stade, seuls les premiers retours du public ont été recueillis grâce à un questionnaire diffusé depuis début mai. Nous comptons profiter du temps fort du festival – du 15 au 21 juillet 2025 – pour intensifier cette collecte directement sur place, et ainsi obtenir un panel encore plus représentatif. Les autres volets de l’enquête sont en cours de préparation ou de lancement.
Une méthode adaptée à un projet culturel
Nous avons construit cette évaluation sur la base de la méthodologie de l’Avise, conçue pour les structures de l’économie sociale et solidaire. Une démarche en 6 étapes qui part des finalités du projet et débouche sur une analyse partagée des résultats. Pour Jazz à Sète, cela a permis de structurer l’évaluation autour de plusieurs axes d’impact :
- Culturel : qualité artistique, fidélisation du public, rayonnement du festival.
- Économique : retombées pour l’économie locale, hébergement, restauration, emplois induits.
- Social : mixité du public, accessibilité, lien social.
- Environnemental : pratiques écoresponsables, mobilités, sensibilisation.
Ce que nous disent déjà les publics
Les 226 premières réponses au questionnaire public donnent déjà un éclairage très riche sur l’impact du festival :
- Un attachement fort au lieu et à l’expérience : une majorité de répondants mettent en avant le cadre exceptionnel du Théâtre de la Mer et la qualité de l’ambiance.
- Un public fidèle : plus de 60 % des répondants ont déjà assisté au festival les années précédentes, et 80 % souhaitent revenir.
- Une portée touristique notable : une part importante du public ne réside pas à Sète mais vient spécifiquement pour le festival, ce qui confirme son rôle dans l’attractivité du territoire.
- Un effet positif sur les commerces locaux : de nombreux festivaliers déclarent avoir profité de leur venue pour consommer dans les restaurants, cafés et hébergements de la ville.
- Une sensibilité à l’engagement écoresponsable : bien que les efforts du festival soient encore peu identifiés, une majorité des répondants est favorable à ce que le festival aille plus loin en matière d’environnement (réduction des plastiques, mobilité douce, etc.).
Autant de données qui, bien au-delà des chiffres de billetterie, racontent une histoire vivante du lien entre un événement et son public.
Des résultats activables pour les partenaires
Ce travail d’évaluation n’a pas seulement produit des données : il ouvre des leviers concrets pour la stratégie du festival et pour la relation avec ses parties prenantes.
- Pour les collectivités publiques, les résultats constituent un argumentaire structuré pour justifier le soutien apporté au festival, en démontrant ses retombées territoriales. Il ne s’agit plus seulement de défendre un projet artistique, mais de montrer en quoi il contribue au dynamisme économique local, au rayonnement de la ville, à l’accès à la culture pour tous, ou encore à la sensibilisation aux enjeux de transition écologique.
- Pour les mécènes et partenaires privés, l’évaluation permet de sortir de la logique du « simple logo » pour valoriser un engagement porteur de sens. Elle met en lumière les valeurs partagées entre le festival et ses soutiens : ancrage local, ouverture culturelle, innovation artistique, engagement environnemental. Ces éléments sont autant d’opportunités pour construire une communication plus narrative et différenciante autour du partenariat.
- Pour l’équipe du festival, les données collectées deviennent un outil de pilotage stratégique : elles permettent d’identifier les points forts sur lesquels capitaliser (par exemple, l’expérience unique vécue au Théâtre de la Mer), mais aussi les marges de progrès (rendre plus lisibles les actions en faveur de l’environnement, élargir certains publics). Elles alimentent aussi la réflexion sur les orientations futures, en ancrant les choix sur des éléments tangibles.
- Pour les acteurs locaux du territoire, commerçants, hébergeurs, restaurateurs, l’évaluation ouvre la possibilité d’un dialogue renforcé avec le festival. En mettant en évidence les retombées économiques indirectes de l’événement, elle légitime leur implication et peut susciter de nouvelles formes de collaboration (offres croisées, mécénat local, co-construction d’animations en ville…)
Enfin, pour le public, partager les résultats de cette évaluation, c’est l’inviter à devenir plus qu’un spectateur : un acteur engagé d’un projet collectif. Cela renforce le lien de confiance avec l’organisation, nourrit un sentiment d’appartenance, et ouvre la porte à une relation plus participative à l’avenir.
Se projeter ensemble
Cette démarche d’évaluation ne s’arrête pas à la production d’un bilan. Elle constitue un point de départ pour une amélioration continue, à la fois opérationnelle et stratégique.
Plusieurs pistes de travail émergent déjà, nourries par les premiers retours et les observations de terrain :
- Améliorer la lisibilité des engagements du festival, notamment sur le plan environnemental. Les publics sont sensibles à ces enjeux, mais identifient encore peu les actions concrètes mises en place. Un effort de communication, de signalétique et de pédagogie pourrait renforcer cet impact.
- Mieux accueillir les publics éloignés, qu’ils soient géographiquement ou socialement plus distants. Cela peut passer par des partenariats avec des structures locales, des actions de médiation culturelle ciblées, ou des dispositifs tarifaires spécifiques.
- Renforcer la dynamique de coopération avec les commerçants et prestataires locaux, en reconnaissant leur rôle dans l’expérience globale vécue par les festivaliers. L’évaluation permet d’objectiver cette valeur ajoutée et de poser les bases d’un dialogue plus structuré.
- Donner une place plus visible aux artistes dans l’évaluation de l’impact, non pas seulement comme « programmés », mais comme co-acteurs du projet culturel, porteurs de messages, animateurs de la relation au public, parfois aussi médiateurs dans le cadre d’actions spécifiques.
- Enfin, associer plus étroitement les bénévoles à la dynamique du festival et à sa valorisation : leur implication est souvent décisive mais peu visible, et l’évaluation peut aussi être un outil de reconnaissance et de mobilisation.
En ce sens, l’évaluation d’impact devient un instrument de gouvernance partagée : elle crée des ponts entre les parties prenantes, rend visibles les interdépendances, et alimente une stratégie plus juste, plus lisible, plus collective.
🎯 En résumé
Évaluer l’impact d’un événement culturel comme Jazz à Sète, c’est mettre en lumière ce que produit un projet artistique dans la vraie vie. C’est aussi donner des clés pour renforcer son ancrage territorial, dialoguer avec ses partenaires, et mieux répondre aux attentes de ses publics. Et c’est peut-être, surtout, une belle manière de faire dialoguer la culture, le territoire et la société.